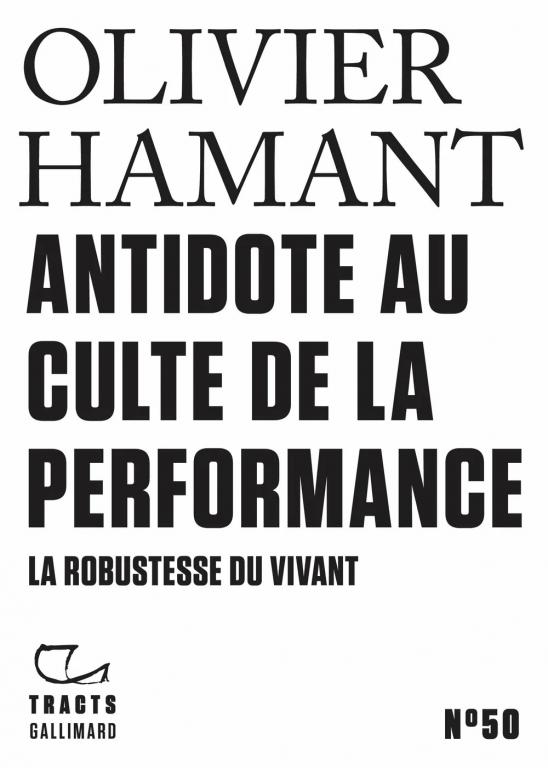Neil Makaroff propose une riposte ambitieuse face à l’extrême droite climatosceptique : électrifier massivement l’Europe et réindustrialiser avec des technologies propres. Mais en restant prisonnier du paradigme de la performance, ce projet répète peut-être l’erreur qu’il prétend corriger. Mise en perspective avec la pensée d’Olivier Hamant sur la robustesse du vivant.
Il y a dix ans, l’Accord de Paris incarnait l’espoir. Aujourd’hui, le mot « climat » a été radié du vocabulaire politique par une vague réactionnaire qui fait de la transition écologique une cible à abattre. Face à ce grand bond en arrière, Neil Makaroff refuse le fatalisme. Dans Décarboner ou décliner ? (éditions de l’Aube), il propose une riposte concrète : un grand plan d’électrification européenne, la création de centaines de milliers d’emplois verts, un parc social de voitures électriques à cent euros par mois, une taxe carbone progressive redistribuée aux plus modestes.

Un projet ambitieux qui allie justice sociale et transformation industrielle. Makaroff ne nie ni les impacts environnementaux de l’extraction (lithium au Chili, cobalt au Congo), ni la précarité énergétique (jusqu’à soixante-douze millions d’Européens concernés), ni les inégalités climatiques. Il reconnaît explicitement ces problèmes et y apporte des réponses redistributives cohérentes.
Pourtant, à lire son ouvrage après celui d’Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance (collection Tracts, éditions Gallimard), un malaise surgit. Hamant nous met en garde : « Face aux bouleversements du monde en cours et à venir, le développement durable, entre géo-ingénierie contreproductive et tout-électrique mal pensé, crée de nombreux futurs obsolètes.» Le projet de Makaroff, aussi socialement progressiste soit-il, ne tombe-t-il pas précisément dans ce piège : celui de vouloir performer écologiquement sans remettre en cause le culte de l’efficacité ?
Le piège de la performance verte
Olivier Hamant, biologiste et directeur de recherche à l’INRAE, pose une question dérangeante : « Et si, pour être sobre et durable, il fallait d’abord questionner une valeur nettement plus profonde : l’efficacité. » Son constat est brutal : nous vivons dans une société de l’optimisation généralisée où même les concepts de croissance verte, développement durable, sobriété énergétique ou management libéré ne remettent pas en cause la sacro-sainte performance.
Le projet de Makaroff illustre parfaitement ce paradoxe. Il propose de remplacer les énergies fossiles par de l’électricité verte, les voitures thermiques par des électriques, les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Une substitution technologique massive, présentée comme la voie royale vers la décarbonation. Mais fondamentalement, il s’agit toujours d’optimiser, de performer écologiquement, d’être plus efficace dans notre consommation d’énergie.
Hamant prend précisément l’exemple des véhicules électriques pour illustrer cette impasse : ils deviennent « un non-sens quand il s’agit de faire des SUV électriques de plus de 2 tonnes nécessitant des batteries lourdes et imposantes, et donc une quantité de métaux rares importante ». Certes, Makaroff propose de réguler les constructeurs via un bonus-malus sur le poids et la taille. Mais pourquoi ne pas questionner plus radicalement notre besoin même de posséder des voitures individuelles ?
Le cœur du problème est là. Makaroff veut « multiplier par trois ou quatre » les énergies renouvelables d’ici 2040, équiper « neuf voitures sur dix » en électrique, remplacer « deux tiers du chauffage » par des pompes à chaleur. Ces objectifs supposent une croissance massive de la production industrielle. C’est performer dans le vert, mais c’est toujours performer.
Robustesse contre performance : deux civilisations opposées
Pour Hamant, « notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Il va maintenant falloir vivre dans un monde fluctuant, c’est-à-dire inventer la civilisation de la robustesse, contre la performance ». Cette opposition n’est pas une subtilité sémantique. C’est un changement radical de paradigme.
Le biologiste prend l’exemple des plantes : dans un monde stable, la performance peut et doit être recherchée, par l’adaptation et la spécialisation. Mais « dans ce monde incertain et fluctuant, ce n’est plus l’hyper-adaptation à une situation qui est optimale, mais plutôt la capacité de s’adapter constamment aux circonstances ». C’est la robustesse qui permet à la plante de réaliser la photosynthèse, quelles que soient la luminosité et la température, « et pourtant, elle n’est pas très performante, ne transformant que 1 % de la lumière ! »
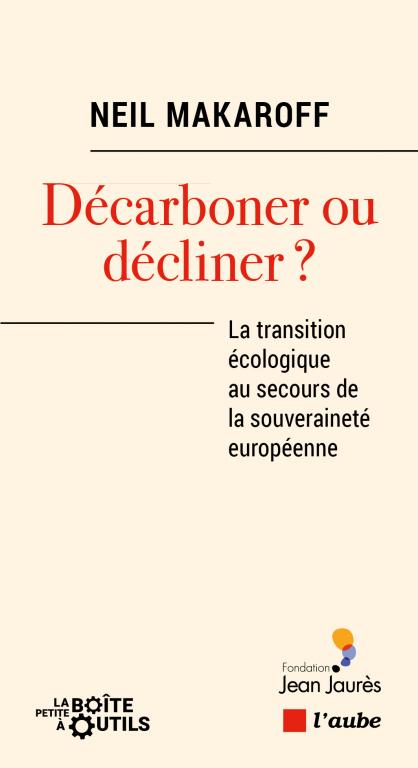
Or le projet de Makaroff repose entièrement sur la performance : performance dans l’électrification, performance dans la décarbonation de l’industrie, performance dans la création d’emplois verts, performance dans la réduction des émissions. C’est une course contre la montre où chaque objectif est quantifié, chiffré, optimisé. Huit cent cinquante-sept mille emplois verts en Europe. Quatre cent quarante-neuf mille emplois créés par le Buy European Act. Trois cent quarante-deux milliards d’euros générés par le marché carbone. Neuf voitures électriques sur dix en 2040.
Cette obsession du chiffre, de la mesure, de la quantification, Hamant nous rappelle qu’elle est précisément ce qui nous fragilise. Comme il l’explique : « Toute performance soumise à une mesure tend à s’auto-justifier jusqu’à aller contre son objet (exemple dans l’éducation où l’objectif d’avoir les meilleures notes conduit à la triche, le bachotage, les passe-droits…) Optimiser fragilise ».
Appliqué à la transition écologique, ce mécanisme devient évident : nous risquons de performer tellement dans la production d’électricité verte que nous oublions de questionner nos besoins réels. Nous risquons d’optimiser tellement la décarbonation que nous créons de nouvelles dépendances (aux métaux rares, à la Chine pour le raffinage, aux infrastructures high-tech). Nous risquons de quantifier tellement les emplois créés que nous oublions de nous demander : produire quoi, pour quoi faire, dans quel but ?
Le leasing social : robustesse ou nouvelle optimisation ?
Prenons l’exemple concret du parc social de véhicules électriques proposé par Makaroff. Sur le papier, c’est une mesure de justice sociale : permettre aux ménages modestes des zones rurales, dépendants de leur voiture, d’accéder à un véhicule électrique pour cent euros par mois au lieu de subir le coût fluctuant de l’essence.
Mais regardons avec les lunettes d’Olivier Hamant. Cette solution optimise le problème existant : elle rend plus efficace, plus sobre énergétiquement, plus abordable… la dépendance automobile. Elle ne questionne pas la robustesse du système. Pourquoi ces millions d’Européens dépendent-ils de la voiture ? Parce que nos territoires sont fragiles, hyper-spécialisés, optimisés pour la voiture.
Une approche par le prisme de la robustesse consisterait à construire un système territorial moins performant mais plus résilient : valoriser « l’hétérogénéité, la redondance, les aléas, le gâchis, la lenteur, l’incohérence » – ces mots que notre société considère comme repoussoirs mais qui sont « les mots-clés de la robustesse ». Une image permet de comprendre le concept, celui du bâti antisismique, souple pour mieux résister.
Concrètement ? Des services publics redondants dans les campagnes (plusieurs petites écoles plutôt qu’un grand pôle scolaire efficient mais éloigné). Des commerces de proximité peu rentables mais qui maintiennent la vie locale. Des lignes de bus peu fréquentées mais qui permettent l’autonomie sans voiture. Des temps de trajet plus longs mais qui réduisent la dépendance au pétrole et aux métaux rares. Du « gâchis » apparent (infrastructures sous-utilisées) qui crée de la résilience.
C’est moins performant. C’est moins efficace. C’est plus robuste.
Le leasing social de Makaroff est une optimisation de l’existant. Une approche robuste transformerait l’existant. La différence est fondamentale.
La réindustrialisation verte : performance ou résilience ?
Sur la question industrielle, Makaroff est particulièrement convaincant. Il démontre que la vague réactionnaire ment aux ouvriers en leur promettant de maintenir l’industrie fossile. Les chiffres sont là : quatre-vingt-cinq mille emplois verts déjà créés en France, avec des perspectives de doublement. Les Hauts-de-France deviennent la « vallée européenne de la batterie ». Dunkerque produit de l’acier décarboné.
Mais une fois encore, interrogeons la robustesse de ce modèle. Makaroff propose de créer des « Airbus des technologies vertes », de massifier la production, de protéger les filières par un Buy European Act. C’est une logique de champion industriel, de montée en puissance, de course à l’échelle. C’est la logique qui a créé Airbus, certes, mais aussi la dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondiales, la fragilité face aux chocs (pénurie de semi-conducteurs, guerre commerciale).
Hamant nous rappelle que dans un « monde d’incertitudes », « ce n’est plus l’hyper-adaptation à une situation qui est optimale, mais plutôt la capacité de s’adapter constamment aux circonstances ». Une industrie robuste ne serait pas forcément celle qui produit le plus de batteries le plus efficacement possible. Ce serait une industrie diversifiée, relocalisée, de taille moyenne, adaptable, moins dépendante des métaux rares, capable de pivoter selon les besoins locaux.
Makaroff reconnaît d’ailleurs implicitement cette fragilité lorsqu’il évoque la faillite de Northvolt, « géant de la batterie européenne ». Un géant optimisé pour la performance tombe plus durement qu’un réseau de PME diversifiées. La concentration industrielle, même verte, crée de la fragilité.
Une réindustrialisation robuste privilégierait des filières courtes plutôt que des champions continentaux ; des technologies low-tech réparables plutôt que du high-tech performant ; de multiples petites innovations locales plutôt qu’une course au gigantisme ; de la redondance productive (plusieurs sites moyens) plutôt que de l’optimisation (un méga-site).
C’est moins efficace sur le papier. C’est plus résilient face aux chocs.
Le temps de travail : l’impensé de la performance verte
Makaroff se félicite de créer des emplois verts. Huit cent cinquante-sept mille en Europe, bientôt le double. Mais il ne questionne jamais pourquoi il faudrait toujours plus d’emplois, toujours plus de production, toujours plus de croissance – fût-elle verte.
Le culte de la performance ne peut pas concevoir la décroissance, même matérielle. Il ne peut pas concevoir le temps libre comme richesse. Il ne peut que traduire toute transformation en termes de productivité, d’emplois créés, de PIB.
Or comme le souligne Hamant, « la performance a comme moteur la compétition et la violence (la loi du plus fort) ». Appliquer cette logique à la transition écologique, c’est maintenir le système de compétition internationale, de course à l’innovation, de guerre économique – simplement déplacée sur le terrain des technologies vertes.
Une transition robuste assumerait de ralentir. De travailler moins pour produire moins mais mieux. De privilégier la réparation à la production. De valoriser le care, l’éducation, la culture – secteurs « improductifs » au sens économique mais essentiels à la résilience sociale. De créer des emplois locaux qualifiés (rénovation thermique, maraîchage, artisanat de réparation) plutôt que des champions high-tech de la batterie.
Makaroff propose un « revenu climat » redistributif. C’est une avancée. Mais pourquoi pas un revenu de base inconditionnel qui permettrait de sortir du chantage à l’emploi productiviste ? Pourquoi ne pas assumer une réduction massive du temps de travail ? Parce que cela nécessiterait de renoncer à la performance, à la croissance, à l’efficacité comme valeurs cardinales.
Justice climatique : taxer ou transformer ?
Sur la question sociale, Makaroff apporte des réponses réelles. Taxer les dix pour cent les plus riches (qui émettent six fois plus que les cinquante pour cent les plus pauvres) pour financer la transition des classes populaires. Redistribuer les trois cent quarante-deux milliards d’euros du marché carbone européen.
Mais là encore, c’est une logique d’optimisation fiscale, pas de transformation structurelle. Les jets privés et yachts seraient taxés, pas réduits. Les SUV seraient découragés par un malus, pas bannis. La publicité n’est jamais mentionnée. Les inégalités de patrimoine ne sont pas questionnées.
Hamant nous alerte : les concepts « à la mode » comme le développement durable ou la sobriété « peuvent se révéler contre-productifs s’ils sont à des fins de performance ». Une taxe carbone progressive peut effectivement devenir un simple outil d’optimisation qui légitime la surconsommation des riches ( « je paye, donc j’ai le droit »).
Une justice climatique robuste interdirait purement et simplement ce qui détruit : jets privés, yachts, croisières, SUV urbains, publicité pour la surconsommation. Non par punition morale, mais parce que dans un monde aux ressources finies et au climat déstabilisé, ces pratiques menacent la robustesse du système entier.
C’est moins « libéral ». C’est plus résilient.
L’électrification massive : robustesse ou nouvelle fragilité ?
Le cœur du projet de Makaroff tient en une formule : « Electrify, baby, electrify ». Face à notre dépendance au gaz russe et au pétrole américain, il propose d’électrifier massivement nos transports, notre chauffage, notre industrie. L’objectif : produire en Europe l’énergie que nous consommons.
La démonstration est imparable sur le plan géopolitique. Deux cent douze milliards d’euros versés au Kremlin depuis 2022. Une inflation record. Une vassalisation énergétique. Remplacer cela par du solaire et de l’éolien européens, c’est reprendre le contrôle.
Sauf que cette nouvelle dépendance n’est sans doute qu’un déplacement du problème. Nous passons de la dépendance au gaz russe à la dépendance aux métaux rares chinois, aux semi-conducteurs asiatiques, aux chaînes d’approvisionnement mondialisées pour les composants high-tech. Nous remplaçons une fragilité par une autre, peut-être pire car plus complexe, plus irréparable, plus concentrée.
Hamant nous rappelle que la robustesse « se construit d’abord sur l’hétérogénéité, la redondance, les aléas, le gâchis, la lenteur ». Un système énergétique robuste ne serait pas forcément celui qui électrifie tout massivement. Ce serait un système diversifié : oui à l’électrique pour certains usages, mais aussi du biogaz local pour d’autres, du solaire thermique simple, des réseaux de chaleur, du bois géré durablement, des technologies low-tech réparables localement.
Ce serait moins performant énergétiquement. Ce serait plus résilient face aux chocs d’approvisionnement.
Makaroff cite d’ailleurs un chiffre révélateur : un grand plan d’électrification pourrait « faire économiser à l’Europe 850 milliards d’euros d’importation de gaz, pétrole et charbon à l’horizon 2040 ». Mais combien faudra-t-il dépenser en importation de lithium, cobalt, terres rares, composants électroniques ? Combien de nouvelles dépendances créons-nous ? Le calcul n’est jamais fait.
Performance et réductionnisme : le piège systémique
Hamant met en lumière un mécanisme fondamental : « Le dogme de la performance nécessairement positive est un formidable soutien à la pensée réductionniste (qui valorise l’appauvrissement des interactions), contre la pensée systémique (qui se construit au contraire sur la complexité des interactions). »
Le projet de Makaroff, malgré des qualités, tombe dans ce travers. Il réduit la transition écologique à un ensemble d’objectifs quantifiables : tant de % d’énergies renouvelables, tant de voitures électriques, tant de tonnes de CO₂ économisées. Cette réduction permet la mesure, donc la performance, donc la compétition, donc la mobilisation politique.
Mais elle appauvrit drastiquement la compréhension systémique de ce qu’est une transition écologique. Celle-ci n’est pas qu’énergétique. Elle est sociale (comment vivons-nous ensemble ?), territoriale (comment habitons-nous l’espace ?), temporelle (à quel rythme ?), relationnelle (comment nous lions-nous au vivant ?), anthropologique (que signifie « bien vivre » ?).
Réduire tout cela à « décarboner ou décliner », c’est faire précisément ce que la pensée performative fait toujours : appauvrir le réel pour le rendre mesurable et optimisable.
Deux visions, deux civilisations
Le débat entre Makaroff et Hamant ne porte pas sur des détails techniques. Il porte sur le type de civilisation que nous voulons construire face au chaos climatique.
Makaroff propose une civilisation de la performance verte : efficace, optimisée, compétitive, industrialisée, mesurée en emplois créés et en tonnes de CO₂ évitées. Une social-démocratie high-tech qui maintient nos niveaux de consommation en changeant les sources d’énergie.
Hamant propose une civilisation de la robustesse : hétérogène, redondante, lente, résiliente, ancrée dans la compréhension du vivant. Une transformation profonde de notre rapport à l’efficacité, à la vitesse, à la croissance.
Ces deux visions ne sont pas forcément incompatibles. Elles pourraient être complémentaires : à court terme, la substitution technologique de Makaroff pour éviter l’effondrement immédiat ; à moyen terme, la transformation structurelle d’Hamant pour construire une résilience durable.
Mais Makaroff ne laisse pas place à cette complémentarité. Son projet repose entièrement sur la substitution technologique performante. La robustesse, la lenteur, la redondance, le « gâchis » nécessaire à la résilience n’ont pas leur place dans son récit mobilisateur.
C’est compréhensible politiquement : comment mobiliser les foules avec un discours sur la robustesse, l’acceptation de l’inefficacité, la valorisation du gâchis ? Comment gagner contre l’extrême droite en proposant de ralentir plutôt que de performer écologiquement ?
Mais c’est peut-être précisément là que se joue notre avenir. Comme le dit Hamant : « Le monde très fluctuant qui vient appelle un changement de civilisation.» Pas une optimisation de la civilisation actuelle. Un changement.
Performer ou persister ?
Décarboner ou décliner ? est un livre important. Il démontre que la transition écologique peut être un projet d’émancipation sociale et géopolitique. Il propose des solutions concrètes, socialement justes, politiquement mobilisatrices.
Mais il reste prisonnier du paradigme qui nous a menés à la crise actuelle : celui de la performance, de l’efficacité, de l’optimisation, de la croissance. Il propose de performer écologiquement là où Hamant nous invite à renoncer à la performance elle-même.
Le risque de la stratégie Makaroff : créer une nouvelle fragilité en annonçant construire la résilience. Optimiser le système pour qu’il continue à tourner vite, alors que la robustesse nécessiterait de le ralentir. Préparer les prochaines crises (épuisement des métaux rares, dépendances high-tech, fragilité des chaînes d’approvisionnement) en croyant résoudre la crise actuelle.
L’avantage : il propose un récit positif, immédiatement applicable, susceptible de couper l’herbe sous le pied de l’extrême droite qui promet le retour au pétrole.
Entre performance verte et robustesse du vivant, l’urgence climatique ne nous laisse plus le luxe de choisir l’un ou l’autre. Il faudra faire les deux : substituer ET transformer, électrifier ET ralentir, réindustrialiser ET simplifier.
Mais la question de la priorité et de l’équilibre reste entière. Makaroff mise tout sur la performance. Hamant nous met en garde : dans un monde fluctuant, la performance fragilise et la robustesse sauve à l’image des écosystèmes naturels qui existent depuis des millions d’années.
La sobriété n’est pas l’ennemie de la justice sociale. La robustesse n’est pas l’ennemie de l’émancipation. Elles en sont les conditions, dans un monde aux ressources finies et au climat déstabilisé. Peut-être est-il temps de le reconnaître, même si cela nous oblige à renoncer au confort rassurant de la performance.
* Présidente des JNE
Photo du haut : Olivier Hamant © Christian Slagmulder