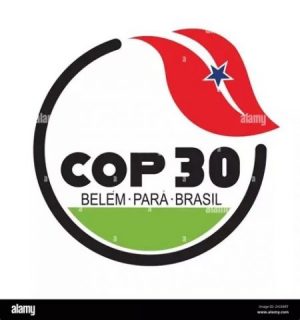par Olivier Nouaillas
Au lendemain de la signature de l’Accord de Paris, Bill Mc Kibben, un activiste écologiste américain, fondateur de l’organisation 350.org, déclarait avec lucidité : « cet accord n’a pas sauvé la planète, mais il a conservé les chances de sauver la planète ». C’était il y a dix ans, en décembre 2015, à l’issue de la COP21 et un certain optimisme régnait alors dans la communauté internationale. Cent quatre vingt-seize pays ne venaient-ils pas de s’engager à limiter le réchauffement climatique à 2 °C, voire à 1,5 °C ? Et après 20 ans de diplomatie climatique, dirigeants des différents gouvernements, scientifiques du GIEC et militants de la société civile semblaient enfin parler d’une même voix et faire de la lutte contre le changement climatique une priorité planétaire absolue.
Dix ans après la signature de l’accord de Paris, c’est plutôt l’inquiétude et le désenchantement qui dominent. Ainsi, pour la première fois, l’année 2024 a dépassé le seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle. Et la suite ne s’annonce guère mieux. « Les engagements des Etats pour réduire leurs gaz à effet de serre sont toujours insuffisants », vient ainsi d’alerter l’ONU à la veille de l’ouverture de la COP30 qui se tient à Belem (Brésil) du 10 au 21 novembre 2025. En effet, dans un long document rendu public par le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), les experts de l’ONU mettent en garde contre « la grave escalade des risques et des dommages climatiques ». Un avertissement qui vient après une année 2025, la troisième la plus chaude jamais enregistrée, selon un autre rapport, celui de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Du récent ouragan Mélissa qui a dévasté récemment la Jamaïque, aux pluies torrentielles qui ont frappé l’Asie et notamment le Vietnam en passant par les incendies des forêts du bassin méditerranéen durant l’été, sans oublier les différentes canicules et autres vagues de chaleur, aucune région du monde ne peut se sentir épargnée par rapport au changement climatique. En effet, selon l’ONU, la poursuite des politiques actuelles conduit la planète vers une hausse des températures mondiales de 2,8 °C d’ici la fin du siècle. C’est mieux que les + 3,1 °C prévus dans le rapport 2024 du PNUE, mais encore bien au-delà du seuil de 2 °C recommandé par les climatologues et redouté de plus en plus comme un point de bascule pour l’habitabilité de nombreuses régions sur la Terre.
Dans ce contexte déjà inquiétant, la situation géopolitique n’incite pas à l’optimisme. Depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024, le climatoscepticisme a repris de la vigueur. Ainsi, l’une de ses premières mesures fut de retirer de nouveau la signature des Etats-Unis des Accords de Paris. Ce qui n’est pas rien quand on représente le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine. Anti-science et ennemi juré du multilatéralisme, le président américain est non seulement un adepte des phrases à l’emporte pièce – « j’ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique », déclarait-t-il en octobre 2025 – mais surtout le chef de file d’une internationale réactionnaire qui a fait, à côté d’autres obsessions identitaires, de l’écologie l’une de ses cibles favorites. Ainsi Trump agrège à lui plusieurs courants anti-écologistes : des milliardaires techno-solutionnistes de la Silicon Valley – qui, comme Elon Musk, font croire que la crise climatique se résoudra par l’innovation technologique – aux pays producteurs de pétrole hostiles à tout frein de l’utilisation des énergies fossiles et qui adorent le slogan trumpiste « Drill baby drill » (Fore chéri, fore).
Même l’Europe, qui était jusqu’à présent un des piliers stables des négociations climatiques, vacille sous les coups de boutoirs de l’extrême droite, voire de certains gouvernements de droite. Ainsi, l’ambitieux Green Deal (Pacte Vert) présenté par Ursula van der Leyen en 2019 a dû être revu à la baisse lors de son second mandat. Et si, début novembre 2025, les vingt-sept pays européens ont maintenu, dans la douleur, leur objectif de réduction de gaz à effet de serre de 90 % en 2040 par rapport à 1990, ils l’ont assorti de nombreuses concessions pour les Etats récalcitrants comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et même l’Italie.
Est-ce à dire qu’il n’y a rien à attendre de bon de la COP30 ? Pas forcément. Un des points positifs, c’est qu’elle soit organisée au Brésil, à Belem, en plein cœur de l’Amazonie, présentée souvent comme « le poumon vert » de la planète et un des enjeux de la bataille climatique. Lula, le président brésilien de gauche, malgré certaines ambiguïtés – fin octobre, il a ainsi donné son feu vert à la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras pour « explorer » du pétrole au large de l’Amazonie – reste à la fois soucieux de mettre un terme à la déforestation de l’Amazonie, un chaud partisan de l’application de l’Accord de Paris et surtout du multilatéralisme qui va avec. « La solution n’est pas de l’abandonner, déclarait-il dans une tribune publiée par Le Monde en juin 2025, mais de le refonder sur des bases plus justes et inclusives ». Et le Brésil a un savoir-faire certain en matière de négociations environnementales.
N’est-ce pas à Rio, en 1992, lors du troisième Sommet de la Terre, qu’ont été adoptées les trois grandes conventions internationales qui régissent depuis le combat mondial pour l’environnement : celle concernant le climat (qui a donné naissance aux fameuses COP), celle sur la biodiversité et celle contre la désertification ? En 2025, à Belem, il s’agira cette fois, non pas de signer un nouvel accord ou de définir de nouveaux objectifs, mais plus simplement de redonner du souffle à l’Accord de Paris. Pour y arriver, une alliance, certes hétéroclite et fragile, entre le Sud global cher à Lula, la Chine et l’Europe sera sans doute nécessaire. C’est moins ambitieux, mais certainement vital pour garder l’espoir de conserver notre planète habitable.
Olivier Nouaillas, ancien vice-président des JNE, est notamment l’auteur du Changement climatique pour les Nuls (First, 2014) et du Grand Guide de la Météo et du Climat (Glénat, 2024, nouvelle édition mise à jour en 2025).