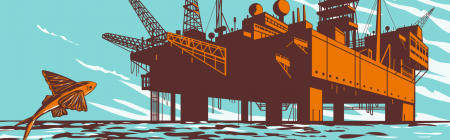L’offshore pétrolier algérien en Méditerranée est revenu cette année dans l’actualité énergétique nationale, tout en hypothèses et avec les mêmes incertitudes qu’avant, mais toujours sur fond d’espérances. Son exploitation dépend de l’existence de ce que les professionnels du secteur appellent « réserves prouvées », c’est-à-dire, expliquent-ils, celles que l’on est « sûrs » (à 90 %) de pouvoir extraire.
par M’hamed Rebah
Pour prouver, il faut forer, or le forage d’un puits avoisine les 100 millions de dollars, a fait savoir, au début de l’année, janvier 2025, Mourad Beldjehem, qui était alors président de l’Agence nationale de valorisation des hydrocarbures (Alnaft). Après 60 ans d’industrie pétrolière, un seul puits a été foré dans les années 1970, rappelle-t-il. C’est un investissement assez conséquent pour Sonatrach qui souhaite partager les risques avec des partenaires étrangers.
Selon Alnaft, l’offshore algérien est constitué du bassin d’Alboran à l’Ouest, et du bassin algéro-provençal au centre et à l’est du pays, situés dans la Méditerranée occidentale. C’est un domaine complexe et inexploré, avec peu de travaux, a expliqué Mourad Beldjehem à la chaîne 3 de la radio algérienne. Il intervenait au lendemain de la Convention d’études sur 24 mois signée, le 22 janvier 2025, avec la société américaine Chevron North Africa Ventures Ltd visant à réaliser une étude sur le potentiel des ressources en hydrocarbures offshore sur les côtes algériennes.
Réduire le risque financier exploratoire
Poursuivant ses explications, Mourad Beldjehem fait remarquer que l’offshore algérien est classé dans les ultra deep, cela signifie qu’il y a des tranches d’eau qui dépassent les 2500 mètres, et il exige une technologie pointue et spécifique.
« Toutes les études qui sont faites, sont destinées à réduire le risque exploratoire, réduire les incertitudes et aller cibler les hydrocarbures là où ils sont», a-t-il précisé. Ce travail a commencé avec des compagnies européennes (Espagnols, Italiens, Norvégiens) pour la prospection, et maintenant Chevron, qui a une grande expérience dans l’ultra deep off shore et qui vient avec une nouvelle approche pour synthétiser tout ce qui a été fait avant.
Alnaft compte beaucoup sur les résultats de cette étude. L’Agence a mis à la disposition de Chevron toutes les données acquises pour lui permettre de faire une évaluation en utilisant les technologies les plus avancées en matière d’exploration sous-marine. Il s’agit d’accélérer la cartographie précise du potentiel offshore algérien et d’optimiser les futures campagnes d’exploration. Il y a également l’espoir que durant les 24 mois de validité du contrat, Chevron identifie une zone d’intérêt et fasse une offre à Alnaft, puis négocie avec la Sonatrach pour signer un contrat de recherche et d’exploitation. Dans tous les cas, les résultats serviront de base pour le premier appel à manifestation d’intérêt international prévu en 2026 pour l’exploitation des hydrocarbures offshore.
Dans le même entretien, Mourad Beldjehem a parlé de l’autorisation de prospection donnée à Sonatrach de février 2023 à février 2025, pour la région Bejaïa Jijel (sur la côte est), puis renouvelée à la demande de Sonatrach pour 6 mois; ses résultats étaient attendus en août 2025. Il a également cité une étude entre Alnaft et une compagnie de services, SLB (anciennement Schlumberger). Un budget de 12 millions de dollars avait été dégagé pour un programme de renforcement des capacités de prospection offshore, pour avoir plus de détails, plus de connaissances à mettre à la disposition des compagnies qui manifesteraient leur intérêt.
En juin 2025, sur les mêmes ondes, chaîne 3 de la radio algérienne, et encore en tant que président d’Alnaft, Mourad Beldjehem évoque les résultats préliminaires de l’étude avec SLB, qui ont montré, selon lui, plusieurs zones d’intérêt susceptibles de présenter un potentiel à explorer. Il estime que l’étude a apporté une nette amélioration de l’image sismique en profondeur permettant de mieux caractériser le système pétrolier (en géologie pétrolière, un système pétrolier est une zone vérifiant des conditions géologiques d’existence de gisements de pétrole et de gaz naturel). Ce sont des résultats positifs, dit-il, et on attend d’avancer dans l’étude avec SLB. Par ailleurs, il confirme que la convention d’études avec Chevron a commencé. D’ici le 4ème trimestre 2026, « on aura quelque chose à proposer dans le Bid Round » (c’est-à-dire l’appel à concurrence qui sera lancé), a-t-il prévu.
Optimisme au conditionnel
Quelques jours après, fin juin 2025, Analft a un nouveau président, Samir Bekhti. Ce dernier confirme l’optimisme ambiant en n’excluant pas l’offshore dans l’appel prévu pour la fin du premier trimestre ou au plus tard le début du second trimestre 2026. Mais il maintient le mode conditionnel : si nous sommes prêts d’ici 2026, annonce-t-il, un bloc offshore pourrait y être intégré. Il y aurait ensuite, pour 2027, un appel spécifique, selon ses propos.
Notre confrère El Watan (17 octobre 2024) en avait fait part un an avant, déjà, en rapportant qu’Alnaft estimait possible d’« annoncer des projets d’exploration d’hydrocarbures en mer (offshore) sur les côtes algériennes, dans le cadre des appels d’offres qui seront annoncés en 2025 ou 2026 ». La même source indiquait que « les études menées jusqu’à présent concernent l’exploration et l’évaluation du potentiel pétrolier du bassin offshore algérien, dans sa partie orientale, sur le périmètre Skikda, et le second sur la partie occidentale, sur le périmètre Habibas ». A la même période, le nom du groupe russe Gazprom est cité comme intéressé par l’investissement dans ce créneau.
Plus récemment, en octobre 2025, à l’occasion du forum Russian Energy Week 2025, tenu à Moscou, le président d’Alnaft, Samir Bekhti, nouvellement nommé, a eu plusieurs rencontres bilatérales avec des responsables de grandes compagnies russes, dont Gazprom International. L’offshore n’a pas été cité, mais il a été question de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat dans les hydrocarbures et les technologies énergétiques.
Les responsables algériens envisagent d’augmenter les réserves nationales d’hydrocarbures avec l’offshore et les hydrocarbures non conventionnels, c’est-à-dire le gaz de schiste. Pour l’offshore, les spécialistes expliquent que l’exploitation des gisements exige une approche rigoureuse et durable, intégrant innovation technologique, investissements ciblés et partenariats internationaux pour faire partager le risque financier et géologique et bénéficier de l’expertise de compagnies familières de l’offshore ultra-deep. Mais quel partenaire étranger va se risquer à prospecter une zone offshore sans garanties de succès ? Sonatrach est-elle tentée de poursuivre seule les efforts d’études et de prospection ? Des anciens du secteur des hydrocarbures, experts en la matière, sont sceptiques sur l’exploitation de l’offshore algérien. Ils se basent sur les études faites à leur époque.
Mais l’enjeu en vaut la peine. L’offshore en Méditerranée représente une alternative stratégique pour diversifier l’approvisionnement énergétique du pays et renforcer sa sécurité à long terme, estime-t-on à Sonatrach. Les arguments majeurs brandis pour y aller sont d’ordre économique et géostratégique : assurer la pérennité des revenus énergétiques de l’Algérie et positionner le pays comme un acteur moderne et compétitif. Les spécialistes algériens mettent en avant les avantages économiques et géostratégiques que pourrait offrir le développement maîtrisé de ces ressources, et ils soulignent, en même temps, les défis à relever, qu’ils situent au triple plan : environnemental, technologique et réglementaire. Ils envisagent un développement maîtrisé de cette ressource.
L’avis des experts
Sur la question de l’offshore algérien, « deux approches séparent nos experts », fait remarquer l’économiste pétrolier Reghis Rabah (El Watand 11 novembre 2024) : « L’une, pessimiste, soutenue par d’éminents spécialistes de rang magistral et ayant pratiqué le terrain comme le défunt ex-P-DG de Sonatrach, Nazim Zouiouèche, et le Dr Nacer Eddine Kazi Tani, qui pensent que notre marge n’a pas de roche-mère qui implique qu’il n’y a pas eu de formation des hydrocarbures et par voie de conséquence, il n’y aurait pas de migration des hydrocarbures même s’ils avaient des roches poreuses et perméables avec celles de couvertures. S’il y avait des pièges comme prônent les études sismiques et leurs modélisations, ils seraient vides. Donc, une perte de temps et d’argent. D’autres, de la stature du Dr Mohamed Saïd Beghoul, ancien explorateur de Sonatrach, soutiennent une approche pragmatique en proposant quelques forages pour mettre fin à ce débat pour passer au stade d’étude de rentabilité. C’est-à-dire, soit poursuivre les recherches dans la haute marge ou prendre ses dispositions pour viser ailleurs ». Reghis Rabah suggère que Sonatrach fore 2 à 3 puits à 350-400 millions, voire un demi-milliard de dollars pour s’assurer du prétendu potentiel offshore et confirmer ou infirmer sa rentabilité.
Les connaisseurs ont sans doute lu le passage ci-dessous, incompréhensible par les profanes, tiré du site d’Alnaft concernant le « contexte pétrolier du domaine offshore : les données de la sismique et de gravimétrie disponible, ainsi que l’analyses des données de puits forés dans la région ont permis d’identifier les éléments de système pétroliers comme suit : les roches mère seraient situées dans des intervalles transgressifs du Miocène (Langhien-Serravalien, Aquitanien-Burdigalien et Messinien) et du Plio-Pleistocène ; les roches réservoirs seraient situées dans les intervalles Torto-messiniennes avec des systèmes turbiditiques ; la couverture serait assurée par les épaisses séries argileuses du pliocène moyen et supérieur, du Tortonien et du serravalien ; les pièges sont essentiellement stratigraphiques ». Presque toutes les affirmations sont au conditionnel.
En remontant le temps sur plus d’une vingtaine d’années, on constate que Sonatrach est familiarisée avec l’offshore. En 2007, un partenariat avait été établi avec la société brésilienne Petrobras, qui passe pour être leader mondial des technologies d’exploration et de production en eaux profondes et ultra-profondes. A la même période, Sonatrach avait décroché, seule, deux blocs d’exploration en offshore en Afrique et, en association avec le groupe norvégien Statoil, un autre bloc en Egypte. Les responsables de Sonatrach estimaient alors que l’expérience acquise en Egypte devait être mise à profit dans l’ouest-africain. Plus récemment, début 2011, la presse avait évoqué également un projet de partenariat algéro-tunisien d’exploration pétrolière offshore au large des côtes tunisiennes.
A ce propos, citant l’APS, l’Agence Ecofin, confirmait, en octobre 2015, que Sonatrach a fait « sa première expérience de découverte offshore, en 2012 en Tunisie, avec le projet Mahdia 2 qui est aujourd’hui une réussite parfaitement prouvée ». La même source donnait le témoignage d’un ingénieur forage amont et directeur de ce projet algéro-tunisien, qui avait vanté cette expérience. Selon l’agence Ecofin, « le puits productif Mahdia 2, situé à 90 km au sud-est du port d’attache de Sousse, a été abandonné, en raison de la forte concentration des gaz H2S et du CO2 ». Il était alors question, d’après la même source, d’un « troisième projet Mahdia 3, dont les travaux devront commencer en 2016 ».
Et l’écologie ?
C’est une information stockée dans les archives, sinon encore dans les mémoires : l’explosion, le 20 avril 2010, de la plate-forme Deepwater Horizon du groupe pétrolier britannique British Petroleum, destinée au forage des ressources offshore dans le golfe du Mexique, dans les eaux territoriales américaines, La catastrophe avait provoqué une marée noire sans précédent, qualifiée de Tchernobyl pétrolier, avec des conséquences dévastatrices pour l’environnement. Immédiatement après l’accident, qui avait, en outre, entraîné la mort de 11 techniciens, l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) avait demandé un moratoire sur l’extraction de gaz et de pétrole dans les zones écologiques sensibles. Mais aucune société pétrolière n’a dit adieu à l’offshore. Trois mois après la catastrophe, des experts prévoyaient que les forages en eaux profondes se poursuivraient malgré les risques. « Les enjeux sont si importants… », expliquaient-ils. En 2024, 85 % des nouvelles découvertes en volume ont été réalisées dans dix champs offshore, selon le site Global Energy Monitor. Pourtant, note la même source, « l’exploitation pétrolière et gazière offshore met en danger les océans tout au long du cycle de vie des projets, mettant en péril la biodiversité marine au niveau local et le climat au niveau mondial ».
Cet article a été publié dans La Nouvelle République (Algérie) du mardi 4 novembre 2025
Image © Global Energy Monitor