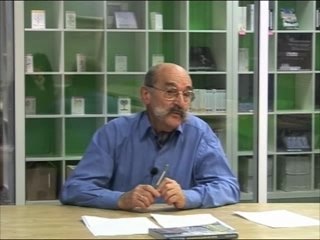Précurseur de l’enseignement de l’écologie en France, Jean-Pierre Raffin, ancien président de FNE et ex député européen, nous fait l’honneur de cette contribution au site des JNE.
Il y a une certaine constance entre le comportement de certains ministres de l’Agriculture ou responsables de ce ministère et la prise en compte de données scientifiques ou de mesures permettant une agriculture soucieuse de la santé tant des humains que des autres vivants. Ils sont contre…Et l’on peut s’interroger sur l’empreinte de la FNSEA sur l’action d’un ministère qui devrait s’intéresser à toutes les formes d’agriculture et non majoritairement à celle qui est la moins soucieuse de la santé du monde vivant notamment non humain. Et pourtant ce dernier est l’assurance- vie de l’humanité (Blandin 2005, Barbault. 2006 ; FAO. 2019 ; Grandcolas. 2021, 2023, 2024).
Quelques exemples :
1985. Art 19 du règlement 797/CEE/85 de la PAC. Il développe le financement d’agriculteurs mettant en œuvre des mesures permettant la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec des exigences de maintien de la nature et des paysages. Alors que la Grande-Bretagne lance rapidement un programme d’application de l’art 19, le ministre français de l’Agriculture tout comme la profession agricole (FNSEA) montrent peu d’intérêt. Il faudra attendre 1993 pour que quelques mesures expérimentales soient lancées.
1986. Le 6 mai, le ministre de l’Agriculture affirme que la France a été épargnée par les retombées radioactives de Tchernobyl…C’est faux, la ligne bleue des Vosges n’est pas une barrière infranchissable… Cette affirmation est liée au souci qu’il n’y ait pas d’embargo sur l’exportation de produits agricoles français.
1990. Le 22 février, le ministre de l’Agriculture affirme à propos de la pollution azotée des eaux d’origine agricole : « On a développé l’élevage hors-sol et les régions qui pratiquent un tel élevage ne sont jamais mises en cause », ce qui est faux…
2001. M. Rico, président de la Commission des toxiques en Agriculture, interrogé, lors d’une réunion organisée par les fabricants de pesticides, par un médecin de la MSA (Mutualité sociale agricole) et le philosophe Dominique Bourg, sur l’impact sanitaire à moyen et long terme des dits pesticides, répond : « Je suis complètement interloqué quand on me dit « Il faut faire attention aux générations futures ». Mais les générations futures, excusez-moi du terme, elles se « démerderont » comme tout le monde » ? (L’on voit à quoi a conduit cette indifférence en lisant L’agriculture empoisonnée : le long combat des victimes des pesticides, de J- N. Jouzel et G. Prete, Editions Presses de Sciences Po, 2024).
Et plus près de nous :
2014. Publication montrant que l’utilisation du glyphosate fait resurgir des pesticides interdits depuis des années (Long-term relationship among pesticide applications , mobility, and soil erosion in a vineyard watershed. P. Sabatier & col. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. November 4. Vol.111. pp 15647-15652.
2015. Conclusion du Centre international de recherche sur le Cancer (CIRC) sur la toxicité du glyphosate « cancérogène probable ».
2016. Le candidat Emmanuel Macron s’engage à interdire l’usage du glyphosate d’ici la fin de son quinquennat s’il est élu, ce que rappelle Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, en septembre 2017.
2018. Un certain 29 mai, au petit matin, est présenté, à l’Assemblée nationale, un amendement d’un député d’En Marche visant à interdire le glyphosate d’ici 2021. 83 députés (sur les 577 que compte l’Assemblée…) sont présents. 20 votent pour, 63 contre, dont 9 députés d’En Marche. Il semble bien que les députés ayant voté contre aient bénéficié du soutien du ministre de l’Agriculture.
La même année, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) publie un rapport sur les alternatives chimiques et non chimiques aux néonicotinoïdes.
« Dans 6 cas : aucune alternative, qu’elle soit chimique ou non chimique, répondant aux critères d’efficacité et d’opérationnalité fixés, n’a été identifiée.
Dans 89 % des cas, les solutions de remplacement aux néonicotinoïdes se fondent sur l’emploi d’autres substances actives, notamment des pyréthrinoïdes.
Dans 39 % des cas, les alternatives chimiques reposent sur une même famille de substances actives, ou une seule substance active, voire sur un seul produit commercialisé.
Et dans 78 % des cas analysés, au moins une solution alternative non chimique existe. »
2020. Le ministre de l’Agriculture demande un rapport sur le bilan des actions visant à réduire l’usage des pesticides (plan Ecophyto). La publication du rapport est bloquée en 2021 par le ministre. Il démontre, en effet, que malgré de très fortes dépenses l’usage des pesticides a augmenté de 13 % en 10 ans au lieu de diminuer.
En juin de la même année, suite à une épidémie de virus de la jaunisse de la betterave transmise par les pucerons, l’ANSES a été saisie pour « identifier des alternatives aux produits à base de néonicotinoïdes applicables à la filière betteravière. Les résultats de cette expertise ont été publiés en mai 2021. Quatre solutions disponibles à court terme ont été ident fiées, ainsi que 18 moyens de lutte substituables aux néonicotinoïdes à moyen terme, dans un délai de deux ou trois ans. Les solutions applicables dans l’immédiat sont deux produits phytopharmaceutiques conventionnels à propriété insecticide, le paillage et enfin la fertilisation organique, afin de contrôler les apports d’azote ».
2021. Rapport de l’INSERM sur divers pesticides dont le glyphosate. En conclusion : « La confirmation et la mise en évidence de présomptions fortes de liens entre certaines pathologies et l’exposition aux pesticides doivent orienter les actions publiques vers une meilleure protection des populations ». Ce ne sera pas le cas.
Publication montrant que l’usage du glyphosate a pour effet de faire ressurgir un pesticide particulièrement toxique interdit depuis 1990, mais toujours utilisé subrepticement (Evidence of chloredecone resurection by glyphosate in French West Indies. P. Sabatier & col. Environmental Science & Technology. 2021 ; 55 . pp. 2296- 2306).
2023. Décembre. Publication du rapport du député Dominique Potier, agriculteur, de la commission d’enquête destinée à « identifier les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire ». Constat que le plan Ecophyto lancé en 2008 après le Grenelle de l’Environnement n’a pas atteint son objectif de réduire l’usage des pesticides, expliquant notamment que les données scientifiques disponibles ont été peu utilisées.
Il est manifeste que l’action de certains groupes de pression (syndicat agricole majoritaire, fabricants et diffuseurs de pesticides) auprès du ministère de l’Agriculture est à l’origine des entraves à l’application du plan Ecophyto.
2024. 4 février . Annonce par le Premier ministre et le ministre de l’Agriculture de la suspension du programme Écophyto.
Par ailleurs, le rapport de l’ANSES sur les risques des nouveaux OGM est bloqué par le ministre de l’Agriculture avant le vote du 7 février par les députés européens sur la question…
2024. 30 novembre. Annonce par la ministre de l’Agriculture d’une « simplification » des actions de l’ANSES et de l’Office français de la Biodiversité, c’est-à-dire, en fait, une minoration dont se félicite la FNSEA.
2025
25 avril. Rapport de l’ANSES sur les pyréthrinoîdes qui « conforte l’alerte sur les effets de l’exposition aux pyréthrinoïdes pendant la grossesse et la petite enfance sur le neurodéveloppement des enfants ». Ces produits sont d’usage en agriculture et dans certains produits domestiques (anti-moustiques par exemple).
10 juin. Confirmation de la cancérogénicité du glyphosate. Une étude menée par l’Institut Ramazzini sur des rongeurs exposés au glyphosate montre qu’ils ont développé des leucémies et des tumeurs bénignes et malignes sur plusieurs organes. Ces résultats sont publiés dans Environnemental Health (in Le Quotidien du Médecin du 13/6/25).
8 juillet. Vote, sans débat grâce à un subterfuge technique d’une loi dite d’orientation agricole portée par un ancien responsable de la FNSEA, soutenue par une ministre de l’Agriculture dont la vision univoque est exclusive et limitée à servir l’agriculture insoutenable promue par la FNSEA.
10 juillet. Publication d’un décret mettant l’ANSES sous tutelle du ministère de l’Agriculture.
Quelques jours après, si l’on en croit Reporterre et Le Canard enchaîné, la ministre de l’Agriculture saisit l’ANSES sur l’acétamipride alors que cette instance s’était déjà prononcée… en 2018 et 2021 (voir plus haut). Nos dits « responsables » politiques ne liraient- ils pas les travaux scientifiques sur les sujets de leur compétence ou auraient-ils la mémoire qui flanche ?
28 juillet. Nomination comme directeur de cabinet de la porte-parole du gouvernement, de l’ancien directeur des affaires publiques de la FNSEA.
Etc.
Et puis l’on peut également s’interroger sur le fait que les pouvoirs publics, dans un Etat qui se dit « de droit », s’accommodent fort bien de l’illégalité lorsqu’elle provient de l’agriculture insoutenable. C‘est le cas par exemple de la retenue de Fourogue (Tarn), illégale « régularisée » près de dix-huit ans après sa construction, de celle de Caussade, (Tarn) construite en 2019 tout aussi illégale mais en voie, semble-t-il , d’être aussi « régularisée » bien que le ministre de l’Agriculture ait assuré en novembre 2023 : « toutes les retenues illégales seront bien évidemment, vidées et démontées »… Ce fait du prince, héritage de la monarchie qui imprègne notre République monarchique, est une pratique que stigmatisait le professeur Yves Mény (La corruption de la République, éditions Fayard, 992).
Le ministère de l’Agriculture ne devrait-il pas se dénommer dorénavant dans le cadre d’une loi de simplification, le ministère de la FNSEA ?
Jean-Pierre Raffin est le co-fondateur (1970) de l’enseignement de l’écologie à la Faculté des Sciences de Paris avec l’écotoxicologue François Ramade.
Photo : Jean-Pierre Raffin © DR