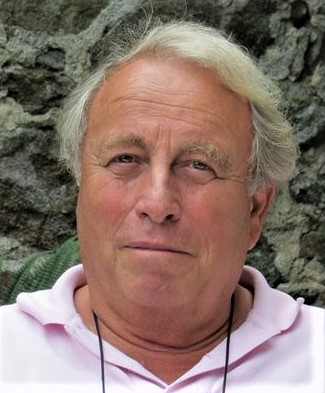La mer, les océans sont surexploités par notre prédation. Il faut gérer la pêche. Tel est l’un des objectifs majeurs du prochain Congrès mondial des océans, qui a lieu à Nice du 9 au 13 juin 2025.
par Alexandre Meinesz (*)
Pour protéger le milieu marin, tous les scientifiques sont d’accord pour affirmer que la surpêche est un des principaux facteurs des désordres écologiques marins constatés. Notre prédation sur les poissons, crustacés et mollusques tend à appauvrir la densité des espèces qui se raréfient dans de nombreuses régions maritimes du monde. Dans ce contexte, il n’est pas assez pris en compte que dans un écosystème, la réduction d’un représentant important de la biodiversité entraîne de multiples répercussions sur les autres espèces, sur les autres échelons de la chaîne alimentaire.
Pour réduire cette atteinte, une solution existe et a fait ses preuves : la création de réserves marines intégrales, où toute forme de pêche est strictement interdite sur des zones couvrant essentiellement les petits fonds (de la côte vers le large où les profondeurs atteignent au moins 100 mètres). C’est dans cette zone éclairée, indispensable à la photosynthèse, que prospèrent, sans exception, toutes les espèces végétales fixées sur les fonds marins. Cette zone côtière est à la fois la plus riche en biodiversité marine et aujourd’hui la plus atteinte par les multiples activités humaines qui se développent sur le littoral. C’est bien elle qu‘il convient de protéger avant tout.
Or il n’y a pas assez de réserves marines. Il faut donc en créer et c’est un objectif déjà adopté au niveau international : les accords internationaux imposent qu’avant 2030, 30 % des eaux territoriales doivent être protégées dont un tiers (10 %) de façon «forte ». Le Congrès mondial des Océans va soutenir cet objectif.
Quelle est la réelle situation actuelle ? En prenant en exemple les côtes françaises de la Méditerranée, il faut se référer à un inventaire indépendant et exhaustif des zones marines qualifiées de protégées. Ces données ont été réunies par des chercheurs de l’université Côte d’Azur (www.medamp.org). Elles portent sur 78 zones marines couvertes par 9 statuts différents de protection. Décrets de création fondateurs et modifiés, règlementations en vigueur, surfaces couvertes par tranches bathymétriques et par type de règlementation de la pêche, charte graphique unifiée : tout y est détaillé. On constate que sur les 78 zones de protection, 55 bénéficient d’une l’appellation légale de « aire marine protégée » et sont sous la tutelle de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Les autres relèvent d’un autre régime juridique de protection (23 cantonnements ou concessions de pêche). Ces derniers, étant pourtant des réserves de pêche fortement protégées, ne sont bizarrement pas considérés comme étant des aires marines protégées ; elles sont plutôt sous la tutelle de l’IFREMER.
L’analyse des surfaces concernées amène un constat fondamental : l’immense majorité des aires marines protégées sont très faiblement, voire pas du tout protégées contre la prédation. Il apparaît ainsi que seulement 0,6 % des eaux territoriales des côtes françaises de la Méditerranée sont aujourd’hui protégées intégralement (toutes formes de pêche interdites). Mais en examinant bien ces zones, on constate que la plupart ne sont pas surveillées par des garde-pêche assermentés (c’est le cas dans les 23 cantonnements et concessions de pêche). Parmi celles qui sont surveillées par des agents spécifiques, les deux plus larges sont dans des zones très polluées (les espaces marins fortement protégés du Parc National des Calanques du canyon profond de la Cassidaigne qui a été le réceptacle pendant des décennies des boues rouges d’une usine d’aluminium et les parages du plus grand émissaire d’eaux usées plus ou moins bien traitées des côtes françaises de la Méditerranée déversées en surface près de Marseille à Cortiou). Nous sommes ainsi plus proches du 0,35 % de zones propres (naturelles), intégralement protégées et surveillées. Quant aux autres zones, la grande majorité des espaces ne sont absolument pas protégées de la prédation : la pêche professionnelle est partout autorisée, les concours de pêche à la ligne ou de chasse sous-marine peuvent y être pratiqués et des constructions gagnées sur la mer y sont même édifiées. Même dans ce qui est pompeusement appelé cœur de parc des deux parcs nationaux français de la Méditerranée, la pêche professionnelle est pratiquée dans la plus grande surface globale.
Sur les 55 « aires marines protégées », 41 ont le statut européen de Natura 2000, mais aucune règlementation contre la prédation n’existe dans leurs documents d’objectifs. Un grand nombre de ces zones chevauchent ou couvrent une autre aire marine protégée (51 % des sites Natura 2000 sont à l’intérieur de zones marines mieux protégées) : ce sont des doublons !
L’immense zone marine internationale (Italie, Monaco, France) appelée sanctuaire Pelagos bénéficie aussi du label d’aire marine protégée. Or cette zone marine n’est pas du tout protégée : elle tend à encourager ou favoriser des observations ou études des 8 espèces les plus fréquentes de cétacés de la Méditerranée qui sont déjà réellement protégées par des réglementations strictes dans tous les pays méditerranéens (dans ce sens, toute la Méditerranée est une aire marine protégée). Le sanctuaire ne veille pas contre tout développement d’activités humaines compatibles avec la préservation des mammifères marins : la nourriture des cétacés y est pêchée et le littoral, domaine des dauphins, continue d’être bétonné comme à Monaco avec les 6 hectares qui viennent d’être gagnés sur la mer pour construire des habitations.
Certains espaces marins situés au droit de terrains du Conservatoire du littoral ont le label d’aire marine protégée alors que la colonne d’eau n’est pas incluse, elle ne protège ainsi que les canards et cormorans !
Le label Aire marine protégée est vraiment un enfumage d’Etat. C’est un mélange confus d’espaces aux gouvernances et statuts différents (Parc National, Réserve naturelle, Parc naturel marin, site Natura 2000, arrêté de biotope, sanctuaire, Conservatoire du littoral), où presque tout est permis entourant parfois de toutes petites zones bien gérées et fortement protégées de la prédation. Il est grand temps de tourner la page de la gestion byzantine de la biodiversité marine pour ménager les pressions locales des usagers de la mer.
Pour être exemplaire et devenir crédible lors du Congrès mondial des Océans, la situation de la protection de la biodiversité marine mérite un sérieux toilettage de vocabulaire. Il faut rendre sincère et compréhensible la situation de la protection du milieu marin. Une appellation scientifique codifiée de la protection des espaces marins doit être proposée. C’est simple et sans coût !
— Les zones marines gérées par une administration où une forme de pèche, de prédation, est autorisée devraient être nommées « aires marines cogérées » et surtout pas « protégées ».
— Seules les zones intégralement protégées devraient être nommées réserves marines. Les parcs nationaux marins seraient ainsi des aires marines cogérées à l’intérieur desquelles il y a de petites réserves marines.
Pour suivre l’évolution de la protection d’espaces marins, il faut être vigilant car des moyens sont en œuvre pour bidouiller les chiffres et se donner une image respectueuse. Soyez attentifs, décryptez les données officielles et dénoncez les stratégies de bidouillage. En France, l’attention devra être portée sur les errances suivantes :
— Il faut supprimer les doublons comme devant les côtes françaises de la Méditerranée où 50 % des sites Natura 2000 se trouvent à l’intérieur d’une autre zone mieux gérée qualifiée d’aire marine protégée. En exemple, le Parc national de Port-Cros, dont l’administration est exemplaire : il est couvert par deux sites Natura 2000 : à quoi servent-ils ? Quelle est le coût de fonctionnement totalement inutile de la gouvernance de ces doublons européens ?
— Au sein de notre ministère en charge de l’environnement coexistent deux administrations distinctes pour la protection du milieu marin contre la pêche (l’OFB et l’IFREMER). Seul l’IFREMER devrait avoir la tutelle de toutes les zones marines réglementées contre la pêche qui est le cœur de son existence. La surveillance par des garde-pêche assermentés de toutes les zones fortement protégées (y compris cantonnements et concessions de pêche) devrait aussi être prise en charge par l’IFREMER avec l’appui des collectivité territoriales. Cet institut spécialisé dans le milieu marin devrait aussi arriver à harmoniser les chartes graphiques des règlementations en vigueur dans les réserves (actuellement trois couleurs différentes sur les cartes publiées indiquent l’interdiction totale de pêche à Port-Cros, à Porquerolles ou dans le Parc national des Calanques !).
Il convient de limiter la création d’aires marines protégées dans les espaces marins du large en dehors des eaux territoriales (dans la zone d’exclusivité économique). Leur mise en place rencontre moins d’hostilité et nécessite peu de concertation avec les usagers de la mer. Six zones de ce type (sous le label Natura 2000) ont été créées en 2017 devant les côtes françaises de la Méditerranée dans le Golfe du Lion et devant les côtes nord-ouest de la Corse. Facile avec cette stratégie d’atteindre 30 % des eaux protégées : il y a aujourd’hui devant les côtes françaises de la Méditerranée 111 153 km² d’ « aires marines protégées » (+cantonnements et concession), dont 86 842 km² de sites Natura 2000 non protégées dans les eaux du large de la zone d’exclusivité économique ! Dans le même registre, pour atteindre les objectifs contraignants des 30 % de zones marines protégées (dont le tiers fortement), il y a une tendance à mélanger les surfaces des eaux territoriales des façades métropolitaines (Atlantique, Manche et Méditerranée) avec les immenses eaux territoriales et zones d’exclusivité économique d’outre-mer et créer des aires marines protégées autour des îles les plus éloignées, isolées, peu ou pas peuplées (comme ce qui est prévu dans l’océan Indien autour d’îlots des terres australes et antarctiques françaises). Il faut exiger une protection identique (même pourcentage) des eaux territoriales des différentes façades maritimes et prioriser la protection des petits fonds les plus atteints par toutes les formes de pêche.
Ne pas jouer sur la définition de « fortement »
Le terme choisi de « fortement » est ambigu. Or seules les zones intégralement protégées permettent un rétablissement maximum des chaînes alimentaires marines. Ainsi l’interprétation du terme « fortement » risque d’être une porte d’entrée d’un bidouillage dans le dénombrement ou la création de zones « fortement protégées » … où certaines pratiques de la pêche sont ou seront permises. C’est même déjà prévu par la loi ! En effet, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, dans son article 227, a créé un article L.110-4 au sein du Code de l’environnement qui indique : « au titre des espaces maritimes, sont reconnues comme zones de protection forte : les cœurs de parcs nationaux, les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale, les zones couvertes par un arrêté de protection ». En prenant toujours l’exemple de la Méditerranée, le cœur du Parc National des Calanques a pour surface 43 600 ha, sur cette surface seuls 4 604 ha sont protégés intégralement, dont plus de 3000 ha en zone polluée. Sur le reste du cœur de parc, seules quelques règlementations s’appliquent sur la pêche de loisir qui est autorisée partout de même que la pêche professionnelle. Ainsi selon le vocabulaire légal, c’est 43 600 ha qui peuvent être comptabilisés « surfaces fortement protégées » (1). Et si on considère les zones couvertes par un arrêté de protection comme étant une zone fortement protégée, on intègre des surfaces immenses des parcs nationaux avec leurs zones adjacentes ou des parcs naturels marins où des arrêtés de protection concernent que certaines contraintes mineures de la pêche de loisir. Il faut exiger que le terme « fortement » signifie « aucune forme de pêche autorisée » : c’est cela une vraie réserve !
En août 2021, à Marseille, le président Emmanuel Macron s’est engagé à atteindre les objectifs internationaux de passer à 30 % des eaux territoriales protégées et 10 % fortement protégées. Le 31 mars 2025, il a réitéré ces objectifs internationaux qu’il souhaite soutenir lors du prochain Congrès mondial des Océans. Sans engagement clair et non biaisé, comment croire maintenant que l’on pourra passer en 5 ans de 0,35 % à 10 % de zones protégées intégralement ? Il faut faire au mieux, donner plus de pouvoir aux collectivités locales pour faciliter la création de vraies réserves et entendre les scientifiques qui œuvrent pour une réelle protection du milieu marin et qui publient les chiffres incontestables de la situation aujourd’hui travestie.
Le monde évolue et sa biodiversité marine mal gérée est en grand danger, il faut ainsi avant tout rendre sincère toute information concernant la protection de la biodiversité et innover en développant un effort volontariste et non byzantin pour mettre en place une politique efficace de protection. Pour que le Congrès mondial des Océans ne se termine pas par de larges déclarations d’intentions, ce sont des décisions concrètes et pragmatiques et avant tout sincères que les citoyens soucieux de la préservation du milieu marin attendent. il est essentiel que le politique s’en empare : le bidouillage sur le dos de la protection du milieu marin devient inadmissible.
(*) Professeur émérite Université Côte d’Azur, auteur de Protéger la biodiversité marine, Ed. Odile Jacob.
www.alexandre-meinesz.com
(1) Il en est de même pour le cœur de parc du Parc National de Port-Cros : sur les 3085 ha de cette zone, seuls 239 ha sont intégralement protégés. Ref. https://medamp.org/index.php/fr/