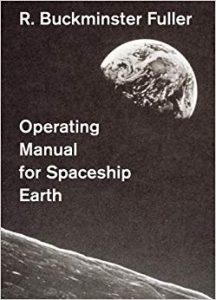D’ici 5 ans… 10 ans… 25 ans, il sera trop tard. Trop tard ! Les futurologues du malheur ne cessent de nous avertir depuis des lustres, tel Philippulus, le prophète maudit de L’Étoile mystérieuse qui harcèle Tintin.
« La nécessité est mère de l’invention »
Attribué, tour à tour, à Platon, Frank Zappa, Pogo (Walt Kelly), etc.

Attention, braves gens, l’échéance arrive, la fin est proche, le bateau coule… C’est un peu comme ces médecins qui assènent un délai à un patient gravement atteint : « Vous n’en avez plus que pour 3 mois, 1 an, etc. ». Or, nous connaissons presque tous d’anciens malades condamnés par la médecine, ayant dépassé le stade de la rémission pour être finalement considérés, des années plus tard, comme guéris. Ne sous-estimons donc pas nos pouvoirs de guérison, de résilience.
Je me suis toujours méfié des prédictions, fins de vies, fins du monde, etc. Cela semble si prétentieux de décréter un chiffre précis pour des lendemains dont on ignore tout… On pourrait se demander si, à force de condamner le futur, on ne risque pas d’instiller un profond défaitisme dans l’opinion publique, une résignation, l’idée désastreuse qu’à ce stade-là, on ne peut qu’attendre la fin sans rien faire.
En ce siècle où nous sommes bombardés d’infos, nous avons tendance à ne retenir que des idées globales, voire caricaturales. De toute évidence, le catastrophisme peut devenir contre-productif. On croit que le choc d’un constat alarmant va stimuler le patient, alors qu’en réalité il le plombe un peu plus, le convaincant que tout est foutu et qu’on ne peut plus arrêter le train fou sur sa lancée. Il est d’ailleurs troublant de retrouver ces thèmes (pollutions, mondialisation, effondrement de la biodiversité, surpopulation) déjà décrits dans d’anciens romans qualifiés alors de science-fiction, et qui semblent étonnamment actuels (par exemple Soleil Vert de Harry Harrison en 1966, ou Tous à Zanzibar de John Brunner en 1968). Au bout du compte, les eschatologues d’aujourd’hui finissent par semer le stress, le fatalisme et la peur, qui sont, comme chacun sait, de bien mauvais conseillers.
Pour autant, il ne s’agit pas de se réfugier dans le déni, nous savons tous que la rupture de certains cycles vitaux peut produire d’imprévisibles effets en cascade, déclenchant eux-mêmes des événements catastrophiques et irréversibles (la liste est longue). La croissance démographique à elle seule, avec ce qu’elle entraîne de surproduction, semble une folie aveugle impossible à freiner. Bien sûr, les données alarmistes se drapent toujours derrière « la science », chiffres à l’appui, mais à force de trop asséner statistiques et prédictions, ne risque-t-on pas de couper les individus de leurs outils les plus sûrs : l’instinct et le bon sens ?
Certes, la peur peut s’avérer utile pour concrétiser une prise de conscience, mais elle peut aussi devenir toxique au service d’une idéologie. La peur tétanise, tout comme les enjeux lointains (même s’ils sont parfois plus proches qu’on ne le croit). Face à tant de mauvais augures, bien des gens sont tentés de gémir : « Mais que puis-je faire, moi tout seul dans mon coin, pour empêcher le réchauffement climatique ? ». D’autres refusent de changer leur mode de vie en se contentant de marmonner (espérant ne pas être entendus) : « Après moi, le déluge… ».
L’enjeu climatique, devenu point de focalisation de l’opinion, est probablement nécessaire à l’éveil des consciences, mais il peut aussi se révéler illusoire sur la durée, voire nous faire douter de notre propre capacité à influer sur le futur. C’est pourquoi les bons gestes doivent être ramenés à la dimension humaine, à notre quotidien. La qualité de l’eau, de l’air qu’on respire, la beauté des aliments que nous choisissons de manger, de ceux que nous faisons pousser nous-mêmes, toutes ces petites choses sont bonnes pour nous et notre environnement immédiat. Par ailleurs, ces gestes contribuent, qu’on en soit conscient ou pas, à lutter contre le changement climatique.
Cela nous ramène au fameux « Penser globalement, agir localement » (concept déjà porté dans les années 1970 par des penseurs comme René Dubos ou Jacques Ellul). L’action locale pensée de façon globale, l’exemplarité, le geste du colibri de Pierre Rabhi, les petits pas, le « kaïzen » cher à Cyril Dion, le low-tech si bien prôné par Corentin de Chatelperron, voilà autant de solutions compréhensibles et applicables dès maintenant par l’ensemble des citoyens, sous toutes les latitudes, alors que les grandes projections climatiques sont mal comprises, voire mal perçues, par une partie du public.
Ainsi, économiser l’eau du robinet, par exemple, devrait être un geste de simple bon sens, une nécessité vitale évidente pour chacun d’entre nous, et non une mesure qu’il faudrait prendre pour le futur de nos enfants ou de la planète. D’ailleurs cette formule un brin démagogique, « faites-le pour vos enfants » nous éloigne des buts immédiats, semblant impliquer une notion de sacrifice au niveau du mode de vie, alors qu’en réalité il s’agit de l’inverse. Faites-le plutôt pour vous, maintenant ! Le situationniste Raoul Vaneigem l’a bien exprimé : « La révolution cesse dès l’instant où il faut se sacrifier pour elle ». On ne demande aucunement aux gens de se priver de ceci ou de cela, ni de retourner vivre « dans une grotte à la bougie », mais bien au contraire de renouer avec les plaisirs les plus simples et authentiques, de retrouver le lien sacré avec les éléments, la nature, un autre rythme, le bonheur d’être, de vibrer à l’unisson avec le vivant. Ici et maintenant…
Arrêtez-vous de lire, là où vous êtes… (Faites-le vraiment). Regardez autour de vous et renouez un instant avec ce qui vit. Une mouche, une plante, un arbre, un chien, un oiseau dans le ciel…
Les véritables seigneurs des lieux
Au fond, en contrepoint au désarroi, pourquoi ne pas chercher des réponses auprès de ceux qui résident sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous ? Ceux qui ont su vivre en harmonie avec la nature sans la saccager, pendant des millions d’années : les animaux et les plantes. Ne seraient-ils pas, eux, les véritables « propriétaires » de cette Terre, et nous des intrus ?
J’ai ainsi vécu une révélation après avoir visité la reconstitution hyperréaliste de la grotte Chauvet-Pont d’Arc en Ardèche. Ces extraordinaires peintures du paléolithique témoignent de deux périodes de présence humaine (environ moins 35 000 ans et moins 25 000 ans). On y trouve 447 représentations d’animaux de 14 espèces, en majeure partie des animaux puissants et non chassés (félins, mammouths, rhinocéros laineux, chevaux, bisons, ours, rennes, aurochs). Sur ces peintures et gravures éblouissantes (parmi les plus anciennes et significatives au monde), on peut voir les amours et la prédation entre ces mammifères.
Au sortir de ce parcours vertigineux, j’ai été saisi par une interrogation lancinante : comment se fait-il que des êtres aussi évolués et doués pour l’expression picturale ne dessinent QUE des animaux, et essentiellement les plus impressionnants ? Pas un seul humain ? Pas l’ombre d’une silhouette ? En outre, l’état de la grotte (à l’identique) est remarquable de « propreté » pour un site fréquenté durant des milliers d’années ! Soudain, la comparaison avec un lieu cultuel saute aux yeux. Nous sommes ici dans un temple, une cathédrale. Or, que représente-t-on à l’intérieur de ces lieux sacrés, dont certains ont traversé les siècles ? Certainement pas nous, les humains, mais bien plutôt nos dieux et divinités. Ceux que nous plaçons au-dessus de nous, ceux qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, et qui ont présidé à notre venue sur Terre… Ainsi, ces humains du paléolithique se voyaient peut-être comme des êtres inférieurs par rapport à ces grands animaux ? Et ces derniers seraient, eux, les dieux !
Lorsqu’on y réfléchit, à la lumière des découvertes récentes (communication animale, humains/animaux, statut de « personne non-humaine » pour certains mammifères, communication entre végétaux…), on pourrait se demander si nous commençons à prendre conscience de l’erreur monumentale que nous avons commise en nous croyant les maîtres du monde et en tenant la faune et la flore pour des espèces inférieures. Et si c’était tout le contraire ? Si les hommes de la grotte Chauvet avaient raison ? N’avons-nous pas tout à apprendre du vivant ? De la fourmi et de l’éléphant ? De l’orchidée et du baobab ? Du plancton et de la baleine ? Ce sont peut-être eux qui détiennent les réponses face aux Cassandre de tout poil ? Alors quelle est notre vraie place sur Terre ?
Faute de répondre à cette question, il est clair désormais que nous devons apprendre du monde vivant lui-même à mieux fonctionner au sein de nos écosystèmes, comme cela se pratique dans l’étude du biomimétisme. Tout est question d’associations utiles, de compagnonnage, d’espèces qui s’entraident et profitent les unes aux autres pour se solidariser et faire fructifier la vie sous toutes ses formes. C’est le principe même de la permaculture. Créer ou recréer des cercles vertueux naturels. En faire une philosophie, un mode de vie. Forces de vie contre forces de destruction. Comme le dit, à propos de la pêche, Yvon Chouinard, précurseur et fondateur de Patagonia : « Il ne s’agit pas simplement de notre relation aux poissons, mais aussi de notre vision : au lieu de vouloir contrôler la nature, nous devrions travailler avec elle ».
Il est temps de renouer avec les animaux et les plantes qui nous entourent, temps de réinventer un langage, une façon de communiquer, même avec une fleur ou un bourdon. Ou, pour citer les mots du philosophe David König : « Si même une araignée se reconnaît dans un miroir, cela signifie que des formes de vie comme les insectes, longtemps exclus du cercle de la pensée, sont dotées d’une forme de conscience. Ainsi tombe l’une des différences essentielles entre l’homme et l’animal. Ceux qui considèrent que l’homme est un animal, de même que ceux qui ont l’occasion de fréquenter les animaux de près, s’en doutent depuis longtemps : il n’y a pas d’exception anthropologique. La sensation et la perception, qui constituent les fondements de l’intériorité, apparaissent partout dans le vivant. Tout vivant est sentant et pensant. C’est ce qu’affirmait déjà Bergson au début du XXe siècle, ce que les peuples premiers savent depuis la nuit des temps, et ce que la science contemporaine redécouvre à travers ses recherches ».
Chaque nouveau lien que nous parvenons à tisser entre nous et le monde vivant, l’eau, l’air, la terre, l’animal ou le végétal, est bénéfique pour les uns comme pour les autres. Nous sommes tous interconnectés. « Aucun homme n’est une île » selon la fameuse phrase de John Donne. C’est pourquoi nous avons besoin d’amour et de résilience. La Terre aussi, a besoin d’être choyée, caressée. Toute la Terre… Or, si l’on prétend aimer notre bonne vieille Gaïa, la Terre-mère, le berceau de la vie, comment peut-on négliger les deux-tiers du globe ?
Permaculture et résilience
En effet, je suis sidéré de voir à quel point l’océan est si souvent absent des grands débats concernant la planète. Sous prétexte que nous connaissons moins de 10 % de la biodiversité marine et des fonds marins (!!), nous devrions les ignorer ? L’océan est, de loin, la plus vaste entité vivante de la planète, le plus grand réservoir de vie. Le brouet originel. Seule l’eau de la mer réussit à mettre d’accord toutes les religions, les philosophies et les sciences, avec cet axiome fondamental : « la vie est née de l’eau ». Les mers chaudes de l’océan originel nous ont donné la vie. Ce dernier représente 71 % de notre planète bleue, si injustement nommée Terre. À ce titre, il devrait être notre priorité absolue et nous devrions tout mettre en œuvre pour le préserver et multiplier les aires protégées, de façon à favoriser sa formidable capacité de résilience. Comme le fait remarquer l’océanographe et plongeur François Sarano, véritable homme-océan du XXIe siècle : « Nous les terriens, nous ne voyons que sa surface de 360 millions de km2. Et l’autre dimension essentielle que l’on oublie toujours, c’est aussi 3,5 milliards d’années d’évolution dans l’océan, alors que la vie à terre ne date que de 420 millions d’années. Ce n’est pas la même échelle de temps et d’espace. Avec 3 milliards d’années d’avance sur le milieu terrestre et aérien, le milieu océanique a développé une diversité d’espèces phénoménale ! … Si l’on arrêtait de pêcher maintenant, on retrouverait en dix ans un océan d’une richesse insoupçonnable. Cela a été observé par le passé, lorsqu’on a cessé de pêcher pendant la Seconde Guerre mondiale et que les populations de poissons se sont reconstituées ».
Aujourd’hui l’océan est trop souvent synonyme de pollutions, plastiques, surpêche, filets, marées noires, animaux morts : baleines, dauphins, requins, thons… Et tout cela est tristement vrai, comme en témoignent depuis plus de cinquante ans déjà les campagnes des grandes ONG telles que Greenpeace, Sea Shepherd ou plus récemment, Bloom. Oui, il y a urgence, sur terre comme sur mer, à protéger, à encourager la vie sous toutes ses formes, pour éviter ces points de rupture qui menacent l’équilibre même du vivant. Mais ne limitons pas la mer, l’âme palpitante de notre planète, à un champ de ruines. Ce n’est pas de soins palliatifs dont l’océan a besoin, mais de gouvernance mondiale, de courage politique, d’éducation, de protection, de sanctuaires marins, de surveillance, d’actions positives…
Heureusement, une armée pacifique se lève de par le monde ; des millions de passionnés, amoureux inconditionnels de l’océan, se mobilisent pour le soigner, le protéger, le dépolluer, le repeupler, le sanctuariser, l’explorer… Face au désarroi alimenté par les dystopies à la mode, il semble plus urgent d’agir que de rédiger des nécrologies pour le futur. « S’attaquer aux solutions plutôt qu’aux problèmes », comme le pointe la navigatrice Catherine Chabaud. Et justement, des milliers de solutions fleurissent – petites ou grandes, individuelles ou participatives, high-tech ou low-tech – pour protéger l’océan et nous réapprendre à vivre avec lui. Nous sommes désormais en mesure de le protéger, le régénérer, tout en y puisant de façon durable ces ressources dont nous avons tant besoin. Ce qui est bon pour l’un doit aussi être bon pour l’autre.
Soyons lucides sans nous laisser envahir par la peur et son ombre : le pessimisme. S’il y a bien une vertu que nous apprennent l’eau et la mer, c’est bien l’amour. Nos frères dauphins, si proches de nous génétiquement, adulés par de nombreux terriens, nous montrent qu’un monde d’amour, de bienveillance, de jeu, de solidarité, est possible. L’océan est sans limites, tout y circule sans cesse, tout s’y mêle et s’interpénètre, démonstration implacable que « Sur le vaisseau spatial Terre, il n’y a pas de passagers, il n’y a qu’un équipage » (Buckminster Fuller). Ici toutes les vies, donc les pensées, nos émotions, sont reliées les unes aux autres. Nous sommes faits d’eau. C’est pourquoi tout nous revient toujours comme un boomerang, le bien comme le mal. Pas besoin de religion pour comprendre cela. L’océan est notre maître, notre modèle. Il nous enseigne aussi l’amour. Cela peut faire ricaner dans les chaumières, mais au bout du compte, au bout des vies, au bout du temps, nourrisson ou grosse brute, on en revient toujours à l’amour comme principe essentiel… À bon entendeur, salut.
Signé : le bisounours de service, et fier de l’être !